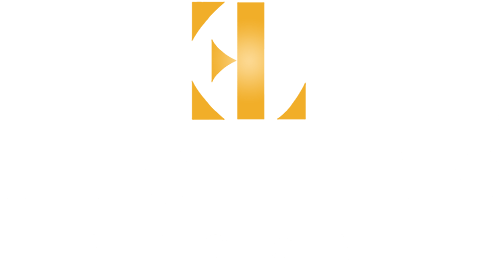Plusieurs décisions récentes des autorités de concurrence examinent la licéité des accords entre concurrents portant sur les ressources humaines :
- les accords informels (gentlemens’ agreements) (A) ; et
- les accords formels consistant en des clauses de non-débauchage insérées dans des contrats (e.g., partenariat, sous-traitance, shareholders’ agreements) (B).
Résumé : les accords de non-débauchage entre concurrents ne sont pas anticoncurrentiels en soi mais doivent être maniés avec précaution. Ont été considérés comme anticoncurrentiels les accords qui ne sont pas limités (i) dans un périmètre géographique et temporel et (ii) à une catégorie de personnels précisément définie, (iii) dont la nécessité n’est pas justifiée et proportionnée au regard d’une problématique de concurrence déloyale et/ou de désorganisation en lien avec l’exécution d’un contrat. Ces accords sont d’autant plus sensibles qu’ils sont informels, réciproques et/ou dans un secteur où les ressources humaines sont un levier stratégique pour l’activité et soumises à une forte demande.
A – Gentlemen’s agreements
Dans sa décision 25-D-03 (recours pendant) sanctionnant quatre entreprises du secteur de l’ingénierie et du conseil à une amende totale de près de 30 millions d’euros pour des pratiques de non-débauchage, l’Autorité de la concurrence française examine les accords informels suivants entre concurrents :
- un engagement de non-agression réciproque consistant à (i) ne pas débaucher, ni recruter une catégorie particulière de personnel (i.e., les business managers), et (ii) ne pas débaucher l’ancienne équipe du manager, sans l’accord de l’entreprise d’origine, lorsque celui-ci rejoint la concurrence ; l’engagement consistait également à se concerter lorsque des mouvements de salariés étaient en projet ;
- un engagement de non-débauchage (non-sollicitation et refus des candidatures spontanées) réciproque, portant sur les ressources humaines impliquées dans la réalisation de prestations réalisées en partenariat pour un client commun ; cet engagement impliquait des échanges d’informations sur les mouvements de personnel en cours ou en projet, conduisant dans certains cas à ce que les embauches prévues par l’une ou l’autre partie, fasse l’objet de « veto» exprimés et/ou soient empêchées.
Pour établir l’existence de ces accords, l’Autorité s’est fondée sur des échanges d’emails internes, en particulier entre les équipes RH et la direction, sur la possibilité d’accueillir ou non les candidatures spontanées provenant d’une entreprise concurrente ou de recruter des profils disponibles sur une plateforme de recrutement. Elle s’est également fondée sur des échanges d’emails intervenus directement entre les directions des entreprises concurrentes.
Ces accords informels ont été considérés par l’Autorité de la concurrence comme des restrictions de concurrence par objet, pour les raisons suivantes :
- ces gentlemen’s agreements présentent un caractère général et ne sont pas limités dans le temps ;
- ils ont pour objet de limiter la liberté commerciale des parties en renonçant à se faire concurrence sur l’un des paramètres de leur activité, à savoir les ressources humaines ;
- les ressources humaines sont un paramètre stratégique dans le secteur en cause, au regard (i) du poids des frais de personnel dans les dépenses des entreprises concernées, (ii) du caractère rare et disputé des ressources humaines et (iii) des mouvements de personnel importants auxquels les entreprises doivent faire face (à noter : la CJUE avait déjà considéré certains personnels comme un « paramètre essentiel de concurrence » dans deux décisions concernant des clubs de football C-650/22, FIFA ; C‑680/21, Royal Antwerp Football Club) ;
- ces accords ne se limitaient pas à prévenir un acte de concurrence déloyale ou une problématique désorganisation massive des équipes, notamment lorsqu’ils visaient à empêcher tout recrutement respectif de business managers, même lorsqu’il s’agissait d’un seul collaborateur ;
- la circonstance que certaines parties n’auraient pas respecté l’accord ne peut être interprétée comme une « distanciation publique », mais simplement comme une absence de mise en œuvre de l’entente, sans incidence la qualification d’entente anticoncurrentielle par objet.
Dans la même veine, la Commission européenne a sanctionné deux entreprises du secteur de la livraison de repas à domicile à 329 millions d’euros d’amende (AT.40795). La Commission visait notamment un accord général de non-sollicitation réciproque par lequel les entreprises sont convenues de ne pas démarcher activement les salariés de l’autre partie, tout en conservant la possibilité de recruter les candidatures spontannées. Cette pratique a été considéré comme une entente anticoncurrentielle par objet pour les raisons suivantes :
- l’engagement de non-débauchage était général, non limité à un groupe spécifique de salariés, bien qu’aucune référence explicite ou preuve ne mentionne qu’il aurait couvert les livreurs ou indépendants ;
- il s’appliquait au recrutement tant au niveau du siège des parties qu’au niveau de leurs filiales dans les Etats Membres de l’Union européenne ;
- des communications internes veillaient à ce que le département en charge des ressources humaines et les cadres soient informés de cet accord et le mettent en œuvre ;
- le recrutement par sollicitation active était considéré par l’une des parties comme un levier important pour recruter des talents et l’expension de l’activité.
Pour la Commission, « les accords de non-débauchage causent généralement un préjudice économique », notamment des effets négatifs sur les salaires, dans la mesure où les parties ne peuvent plus proposer de manière proactive des salaires plus élevés pour inciter les employés à changer d’employeur, et/ou faire des contre-offres pour inciter leurs propres employés à rester. Les accords de non-débauchage seraient ainsi susceptibles d’entraver l’allocation efficace des employés et conduire à une baisse de la productivité, et donc à un ralentissement de la croissance du PIB.
B – Clauses non-sollicitation figurant dans des contrats (partenariat, sous-traitance, shareholders’ agreement)
Dans la décision 25-D-03 précitée, l’Autorité examine également des clauses de non-sollicitation (non-débauchage et refus des candidatures spontannées) visant tout collaborateur de l’autre partie intervenu dans la réalisation de prestations objet de contrats de partenariat ou de sous-traitance. L’Autorité a écarté la caractérisation d’un objet ou d’effets anticoncurrentiels de ces clauses de non-sollicitation, lorsque les conditions suivantes étaient remplies :
- les clauses sont en lien avec l’exécution d’un contrat, étant insérées dans des conventions de groupement (GME) constituées en vue de répondre à un appel d’offres ou dans des conventions de sous-traitance ;
- leur champ d’application est limité à une catégorie précise de collaborateurs : (i) le personnel chargé de la préparation des offres, notamment des grilles de décomposition des prix, et/ou (ii) le personnel intervenant dans la réalisation des prestations ;
- elles s’appliquent pour une période limitée à l’exécution des contrats concernés, et parfois douze mois suivant leur terme compte tenu des nécessités d’accompagnement post-contractuel du client final ;
- leur objectif était de garantir la bonne exécution du projet pour lequel des recrutements importants seraient préjudiciables à sa réalisation (désorganisations, délais, coûts, etc.) ;
- le caractère non-réciproque dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, engageant seulement le donneur d’ordre vis-à-vis du personnel de son sous-traitant, limite d’autant plus le champ d’application et donc le potentiel caractère anticoncurrentiel ;
- les clauses prévoient une indemnisation en cas de non-respect de l’obligation de non-sollicitation qui ne compenserait que partiellement le préjudice subi en cas de débauchage d’un collaborateur et ne revêtrait donc pas de caractère dissuasif significatif (en l’occurence ces indemnisations n’étaient pas appliquées en pratique).
En revanche, dans d’autres affaires, les clauses de non-sollicitation ont été considérées comme étant anticoncurrentielles par objet dans les circonstances suivantes :
Dans une décision concernant le secteur des produits préfabriqués en béton (24-D-06 –recours pendant), l’Autorité examine une clause de non-débauchage figurant dans une convention de prestation de services techniques entre deux concurrents. La clause prévoit que les concurrents conviennent de ne pas recruter des salariés ou mandataires sociaux de l’autre partie, pendant toute la durée du contrat et deux ans suivant sa cessation. L’Autorité ne précise pas sa grille d’analyse, mais relève que :
- le champ d’application n’est pas limité à un groupe précis de salariés puisqu’il portait sur l’ensemble des salariés et mandataires sociaux ;
- la durée de l’accord excède largement la durée du contrat, sans justification ;
- selon l’Autorité, les parties en cause n’auraient pas apporté d’éléments de nature à montrer que cette pratique pouvait être exemptée (sans plus de précision).
Dans sa décision concernant les entreprises de livraison de repas précitée (AT.40795), les pratiques incriminées par la Commission comprennent notamment plusieurs clauses de non-débauchage figurant dans les shareholders’agreements concernant la prise de participation minoritaire de DeliveryHero dans Glovo :
- ces clauses n’ont pas de durée spécifique ;
- leur périmètre géographique n’est pas limité à un pays spécifique ou une région au sein de l’EEA, de ce fait applicable dans tout l’EEA ;
- leur portée est limitée à une catégorie de salariés « Key Employees », définis comme toute personne exerçant ou ayant exercée un poste de manager ou de senior, au cours des douze derniers mois ou des deux dernières années ;
- les différentes clauses unilatérales constitueraient des obligations de non-débauchage réciproques de fait ;
- la concurrence est forte entre les parties pour attirer des talents dans un contexte de pénurie et de forte demande ;
- aucune obligation de non-débauchage équivalente n’est appliquée aux autres investisseurs détenant une participationdans dans Glovo, ce qui écarterait leur caractère objectivement nécessaire et proportionné pour proteger la valeur des investissements ;
- ces clauses ne peuvent pas constituer une restriction accessoire à une opération de concentration, puisqu’il s’agissait de l’acquisition d’une participation minoritaire non contrôlante au sens du droit de la concurrence (i.e., l’acquisition d’une participation contrôlante aurait pu conduire à bénéficier de cette exemption).