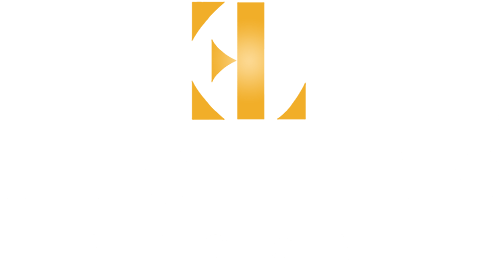1. Pratiques anticoncurrentielles

Échanges d’informations anticoncurrentiels : Des discussions entre concurrents sur des informations générales et/ou anonymisées peuvent constituer des échanges d’informations anticoncurrentiels (Tribunal de l’Union européenne (TUE), T-84/22, secteur des opérations de change), dès lors que :
- les informations anonymisées, par leur objet, leur degré de précision et le fait qu’elles ne sont pas accessibles aux concurrents, sont susceptibles de renseigner des professionnels du domaine sur les mouvements du marché et leur conférer un avantage commercial ;
- les renseignements sur le marché dépassent manifestement des observations sur son état général, même s’ils ne précisent pas de montants, de niveaux de taux, ou ne portent pas sur des actions prospectives. Par exemple, des informations sur la nature ou le type de client concerné (en l’occurrence, de grandes entreprises, des entreprises internationales) sont susceptibles de permettre à des professionnels du domaine, de supprimer certaines incertitudes en accroissant la transparence sur le marché.

Déclarations publiques unilatérales : À l’occasion de l’examen de la licéité d’une décision autorisant des opérations de visite et saisie (TUE, T‑188/24, secteur de la fabrication de pneus),
- le TUE détaille la méthode de la Commission pour identifier des déclarations publiques suspectes pouvant constituer des indices suffisamment sérieux d’une collusion : notamment les déclarations qui portent sur la façon dont les concurrents devraient déterminer leurs prix, sur une volonté d’agir sur le marché en tant que leader ou suiveur en matière de prix et/ou sur la manière de réagir aux changements de prix des concurrents :
– mise en œuvre d’une veille des marchés, dans divers secteurs et dans plusieurs zones géographiques, afin d’analyser plusieurs centaines de milliers de conférences d’annonces de résultats, obtenues auprès de fournisseurs de données financières, pour rechercher des déclarations suspectes ;
– analyse quantitative de cette base de données selon deux catégories de mots clés : (i) une catégorie composée de bigrammes (deux mots consécutifs) liés au champ lexical des décisions commerciales stratégiques et (ii) une catégorie liée aux déclarations concernant la manière dont les concurrents se comportent ou se comporteraient à l’avenir ;
– analyse qualitative des déclarationsdans les secteurs où une fréquence élevée d’occurrence des bigrammes est constatée : identification des déclarations annonçant publiquement un comportement qui venait d’être adopté ou qui allait être mis en œuvre ou suggérant aux concurrents d’adopter un comportement, notamment celles commençant par les termes « nous voulons envoyer un signal » (« we want to send a signal »), « nous avons l’intention de » (« we have plan to »), « la stratégie est de se concentrer sur » (« the strategy is to focus on ») ; « nous nous efforçons de nous en tenir à » (« we strive to stick to ») ; « nous ferons de notre mieux pour » (« we will do our best to ») ; « nous sommes capables de » (« we are able to »), ainsi que « ce n’est pas notre intention d’aller vers » (« not our intention to go for ») ;
– vérification que ces déclarations ne répondent pas à une exigence légale ou que leur régularité ne correspond pas à un comportement standard par comparaison à d’autres secteurs ;
– examen d’autres annonces publiques relatives aux prix des produits ou à l’évolution du prix des matières premières et de l’énergie : (i) proximité des dates des annonces des concurrents ; (ii) alignement des déclarations des concurrents lorsque les prix des matières premières et de l’énergie évoluent (e.g., déclarations similaires qui tendent à indiquer que les prix devaient être augmentés quand une augmentation des prix des matières premières et de l’énergie survient) ;
- le TUE apporte également des précisions sur le standard de preuve pour constituer des « indices suffisamment sérieux » nécessaires pour justifier une décision autorisant des OVS :
– la Commission n’est pas tenue d’indiquer en détail les informations et preuves relatives à la coordination soupçonnée (i.e., la nature ou la forme de ces éléments, leur date et leur auteur) au moment où elle notifie à l’entreprise la décision ordonnant une inspection ;
– le fait que les éléments retenus par la Commission puissent faire l’objet d’interprétations divergentes n’empêche pas qu’ils constituent des indices suffisamment sérieux, dès lors que l’interprétation privilégiée par la Commission apparaît « plausible » ;
– dans l’appréciation de ce caractère plausible, (i) les éléments doivent pouvoir être rattachés à l’objet de l’inspection et aux indices suffisamment sérieux qui fondent les soupçons d’infraction et (ii) les différents indices permettant de suspecter une infraction doivent être appréciés non isolément, mais dans leur ensemble, et ils peuvent se renforcer mutuellement ;
– le fait que les déclarations en cause résulteraient de réponses aux questions d’analystes financiers ou répondraient à des exigences réglementaires ne serait pas suffisant pour écarter la plausibilité de l’interprétation privilégiée par la Commission.

Abus d’exclusion via la conclusion d’accords d’exclusivité par un producteur de verre alcalin détenant une position dominante (communiqué de presse):
- Les pratiques reprochées consistaient en des accords d’exclusivité avec les équipementiers incluant (i) des obligations d’approvisionnement exclusif pour une grande partie de leurs besoins (ii) l’octroi de remises sous réserve du respect de ces obligations d’approvisionnement exclusif, et (iii) des « clauses anglaises » obligeant les équipementiers à signaler les offres concurrentielles émanant de producteurs de verre concurrents et autorisant ces équipementiers à accepter ces offres uniquement si le producteur ne s’aligne pas sur le prix proposé ;
- La Commission accepte les engagements du producteur de verre à (i) renoncer à toutes les clauses d’approvisionnement exclusif dans les accords actuels et futurs avec ses clients, (ii) renoncer à exiger des clients qu’ils s’approvisionnent auprès de lui pour une part de plus de 50 % de leurs besoins et à subordonner à cette exigence des avantages en matière de prix, (iii) à fonder ses actions en justice uniquement sur la contrefaçon des brevets, et non sur la violation du contrat d’approvisionnement.

Abus de position dominante : la Cour d’appel de Paris confirme la décision sanctionnant la filiale réunionnaise du sucrier Téréos pour une pratique de verrouillage sur le marché de l’approvisionnement de la mélasse de canne à sucre à destination des distilleries de La Réunion (décision du 13 juillet 2025, 21/21673) :
- l’abus de position dominante du producteur de sucre n’est pas établi dès lors que la discrimination tarifaire en cause n’a pas produit ou n’était pas susceptible de produire un désavantage dans la concurrence sur le marché aval de la commercialisation pour le distributeur, compte tenu de sa marge significative qui lui permettait d’aligner des prix compétitifs ;
- une clause d’indemnité de sortie du contrat a été considérée comme excessive compte tenu de (i) sa durée (dix ans et reconductible tacitement pour une durée de cinq ans), (ii) de son application même en cas de respect d’un long préavis (trois ans), (iii) de son montant représentant plusieurs fois la valeur des achats annuels réalisés par les distributeurs, empêchant ceux-ci de sortir du contrat et restreignant fortement leurs possibilités de renégociation des tarifs ;
- une clause d’interdiction de revente de la mélasse, en particulier en cas de surplus résultant des engagements respectifs de volume d’achat des distributeurs, limite les débouchés potentiels de revente pour les distributeurs, et revient à réserver aux producteurs l’exclusivité de la vente de la mélasse qu’ils ont produite, renforçant le verrouillage des possibilités de sortie du contrat d’approvisionnement qui découle déjà de la clause d’indemnité de sortie de contrat.
2. Contrôle des subventions étrangères

Projet de lignes directrices relatif à l’application du règlement relatif aux subventions étrangères (communiqué de presse) – consultation ouverte jusqu’au 12 septembre. Le projet de lignes directrices fournit des orientations sur :
- la manière dont la Commission conclut à l’existence d’une distorsion de concurrence causée par une subvention étrangère, que ce soit dans le contexte de l’examen des concentrations, des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, ou d’une saisine d’office ;
- la manière dont la Commission examine si les effets positifs d’une subvention étrangère contrebalancent ses effets de distorsion de concurrence ;
- le pouvoir qu’a la Commission de demander une notification des subventions, lorsqu’elles sont inférieures aux seuils de notification.